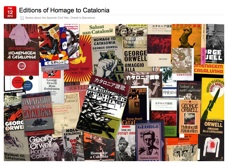GEORGE ORWELL,
LA DECOUVERTE DU POLITIQUE
par Charlotte Goëtz-Nothomb
© POLENORDGROUP

GEORGE ORWELL,
LA DECOUVERTE DU POLITIQUE
par Charlotte Goëtz-Nothomb
© POLENORDGROUP



Cite-t-on George Orwell et, à l’instant, en écho, on entend… 1984!
Or, ce titre de son dernier livre n’était déjà pas celui qu’il avait choisi, puisqu’il avait intitulé sa fiction The Last Man in Europe. Pour comprendre 1984 et parler sans trop d’erreurs de l’approche «du politique» par cet écrivain original, je vous propose de cheminer à ses côtés avant 1984 afin de synthétiser ce qu’il a écrit et qui pourrait nous aider à aller plus loin.
Eric Arthur Blair - George Orwell ne sera adopté qu’en 1933 - est né le 25 juin 1903, à Motihari en Inde britannique, la présidence du Bengale, près de la frontière du Népal. Ceci se passe pendant le Raj britannique, une période de presque 200 ans où, à partir de 1757, les régions d’Inde ont été colonisées à différents niveaux par la couronne britannique.
J’insère ici une parenthèse: aujourd’hui, dans cette même région, les populations très mélangées, surtout rurales, sont très pauvres et aux prises avec de graves conflits politico-religieux dont sont surtout victimes les musulmans de la part des bouddhistes. En 2013, une vague islamophobe a laissé des milliers de cadavres.
A Motihari, aujourd’hui, la modeste maison natale
d’Orwell est plutôt délabrée.
Le Nouvel Observateur a publié un article
disant qu’elle avait été transformée en étable,
surtout pour des cochons, ce qui aurait fait sourire
l’auteur de La Ferme des Animaux.
Un panneau bilingue, installé par le Rotary Club,
signale aux touristes que le lieu concerne Orwell.
Tout bébé, Eric Arthur quitte Motihari avec sa mère et Marjorie, sa sœur aînée, pour rentrer en Angleterre.
Notez ce contexte familial particulier: à part trois mois de permission suite à la naissance d’une fille cadette prénommée Avril, Richard Blair, le père, est loin des siens.
Il travaillera en Inde jusqu’en 1912. Orwell décrit sa famille comme appartenant à la «lower-upper-middle class» (classe moyenne inférieure-supérieure) avec un grand-père maternel impliqué dans les spéculations colonialistes, un autre grand-père pasteur et son père, fonctionnaire de l’Administration des Indes britanniques, chargée de la Régie de l’opium. Souvenez-vous: Hergé nous parlait, dans Le Lotus bleu de l’opium transporté d’Inde en Chine par les Anglais.
Comme écolier et puis collégien, Eric Arthur est studieux et s’ennuie, il fait du sport et aime la pêche. Il est très proche d’une famille, les Buddicom, et surtout de Jacintha Buddicom, en fait son premier amour. Leur activité préférée ? Lire et écrire de la poésie !
D’abord interne à la Preparatory school St Cyprien d’Eastbourne – les revues scolaires de l’époque signalent, de sa plume, textes et poèmes - il étudie jusqu’en 1921 dans la réputée King’s School d’Eton, où il a comme professeur de français, Aldous Huxley, le futur auteur de Brave New World (Le Meilleur des Mondes).
Eric a maintenant 18 ans et demi et ce qu’il préfère toujours, c’est écrire, écrire…
Il lance un magazine, il participe à des publications. Il nous dit qu’il sait pertinemment que le métier d’écrivain est un défi, qu’il faut travailler d’arrache-plume pour obtenir un résultat valable. En même temps, il ne veut pas dépendre de sa famille. Alors, il repart en Birmanie et là, après neuf mois de formation, il devient sergent de la police impériale anglaise et officiera dans de très nombreux lieux. Le choix de ce travail peut étonner mais Eric Arthur a, d’entrée de jeu et pour toute la vie, outre son sens aigu de l’autonomie, une double exigence: n’écrire que sur des situations qu’il connaît de l’intérieur en les transposant littérairement. Dans ce cas, j’ajouterais qu’il s’agit aussi de comprendre son père.
Son expérience en profondeur du colonialisme anglais va lui donner les premières pistes pour appréhender le politique et se former dans ce domaine.
En Inde, des réglementations ont été prises dans le sens d’une décolonisation; en Birmanie, tout est très flou: la colonisation anglaise est là et, en même temps, elle n’est plus là. On trouve des factions en désaccord puis se mettant d’accord sur de grandes décisions. Ces ambiguïtés, nous les percevons dans des formules d’Orwell: «Ne fais pas ce qu’un Asiatique peut faire» mais aussi: «Le fonctionnaire anglais maintient le Birman à terre pendant que l’homme d’affaires lui fait les poches».
Dans quels écrits le jeune homme nous livre-t-il cette expérience décisive?
Un essai: A Hanging (Une Pendaison - 1931); Burmese days (Une Histoire birmane - 1934), son premier roman et une nouvelle Shooting an Elephant (Comment j’ai tué un éléphant - 1936).
Une Pendaison est un texte de quelques pages, pas très connu, où est immédiatement présente une question récurrente chez Orwell: «Qu’est-ce qui est humain ?». Dans tout son parcours, il recherche la spécificité des humains, les activités, la pensée et la liberté qu’implique l’humanité et il pourchassera les processus de déliquescence voire de dissolution qui la sapent.
Résumés: Au début de Une Pendaison, le lieu est décrit. Des personnages entrent en scène pour ce qu’ils appellent un rituel. Puis arrive le condamné qui avance très lentement vers la potence. Soudain cet homme fait un pas de côté pour éviter une saleté sur le sol, il perd l’équilibre et se fait mal. C’est le point de rupture du récit. Ce condamné est un être humain et, pour Orwell, nommer ce qui va se passer un rituel devient inaudible. Un chien intervient d’ailleurs, essayant de lécher le visage de l’homme. S’affirme alors une première vérité qu’Orwell veut partager avec nous: tout spectateur est aussi un être humain et il participe à un acte inhumain. C’est insupportable, il faut en finir. Mais que peut signifier «en finir» à ce moment-là du rapport de forces ? Rien d’autre que la pendaison car il est trop tard.
Dans Une Histoire birmane, nous sommes dans une localité isolée avec une poignée de colons britanniques et des Birmans, quelques buffles et des moustiques… Ce cadre réduit souligne la dimension pathétique des attitudes adoptées par les personnages. Orwell fait ressortir le caractère pitoyable de sa situation de cadre anglais. Il décrit le quotidien de ces fonctionnaires qui se réconfortent en se saoulant dans des clubs privés et dont les propos concernent surtout la mainmise économique et le maintien de l’ordre. Et les Birmans ? Eux non plus ne ressortent pas grandis de la situation. U Po Kyin, juge birman, gros, bouffi et corrompu n’a qu’un rêve: être accepté dans le club réservé aux Anglais.
Dans ce premier roman, le personnage central est Flory, un marchand anglais de 35 ans.
Flory aime et déteste la Birmanie. Il aime et déteste l’Angleterre et finira par se suicider.
Avec le recul, l’expérience d’Orwell est quasi unique: il est un des rares personnages publics britanniques à avoir, dans l’entre-deux-guerres, vécu partout en Birmanie, acquérant une connaissance approfondie du terrain depuis la capitale jusqu’aux endroits les plus reculés et cela, contrairement à la majorité de ses collègues qui vivent surtout à Rangoon, où prospèrent les fameux clubs: bridge, cricket, golf…
Orwell se montre particulièrement sensible au corps humain - nous l’avions déjà remarqué dans Une Pendaison. Dans Une Histoire birmane, il décrit les bras et les jambes de ces Birmans décharnés par la sous-alimentation, les corps souillés des femmes birmanes qui survivent grâce à la prostitution, les corps atrophiés des enfants illégitimes, ces yellow bellies, reniés par les colons et par les colonisés ou encore les corps marqués des coups de lathi, ces bâtons traditionnels dont abusent les colons, effrayés par leur petit nombre face à cette «mer de visages jaunes». Orwell est aussi pleinement conscient de l’extrême fertilité de la terre birmane, qui fournit en riz une grande partie du sous-continent.
Comment j’ai tué un éléphant (Shooting an Elephant) a été publié dans le magazine New Writing, 1936 et ne sera diffusé par la BBC qu’en 1948. Il transpose un épisode étonnant de la carrière d’Orwell en Birmanie.
Résumé: Un éléphant est devenu agressif et a écrasé un coolie. Sous la pression d’une foule de Birmans en colère, l’officier de police anglais est sommé de le retrouver et de le tuer. Orwell décrit avec une précision infernale tous les sentiments qui le traversent et l’absurdité de ses fonctions. D’autant que l’éléphant, qui s’est calmé mais sur lequel l’officier a fini par tirer, à plusieurs reprises, très maladroitement, n’arrive pas à mourir et ne terminera son existence que dépecé par la foule.
A travers ces écrits, Orwell stigmatise la prétendue «mission civilisatrice» coloniale, dont le but est surtout de pérenniser, avec un grand cynisme, la puissance économique déjà décadente du pays colonisateur.
En 1927, passant de «l'ennui au son des clairons» à une rupture consciente avec sa fonction, il prend une décision irrévocable: il rentre en Angleterre et donne sa démission.
Tout au long des 22 années qu'il lui reste à vivre, il sera un ennemi déclaré de l'impérialisme britannique qu’il appellera toujours imperial racket.
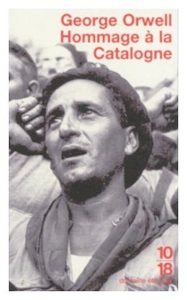
De 1928 à 1936, Orwell vit d’emplois précaires. A Paris d’abord, où il est plongeur dans un grand hôtel de la rue de Rivoli. A Londres ensuite, où il s’immerge dans le milieu des clochards.
Il sera aussi enseignant dans de modestes écoles privées. Et il écrit sur toutes ces expériences, affinant sa conception du monde et ce qu’il entend par «attitude humaine».
C’est pour la publication en 1933 de son livre Dans la dèche à Paris et à Londres (Down and out in Paris and London) qu’il adopte le nom GEORGE ORWELL, dérivé de la rivière Orwell dans le comté de Suffolk. Ce livre est un témoignage de son honnêteté intellectuelle. Orwell ne fait pas seulement un «reportage» à travers des interrogatoires, il vit au quotidien avec les clochards.
Son ouvrage questionne en direct les relations qui nous positionnent les uns par rapport aux autres et liquide beaucoup d’a priori de classes, de castes et de croyances. Dans ce livre, Orwell emploie souvent le mot: «nous». Il passe soigneusement en revue les détails de la vie de ces pauvres personnes: les petits boulots, la mendicité, les asiles de nuit, l’argot, la musique, les chansons, les conflits et la solidarité... Toute sa vie, Orwell montrera, à contre-courant, que, malgré mais aussi grâce à l’extériorité à des situations imposées ou aux privilèges, des qualités humaines fortes sont préservées.
Les années qui suivent verront son implication dans la vie des mineurs, sa rencontre avec la psychologue Eileen 0’Shaughnessy et leur mariage en juin 1936. Deux ouvrages autobiographiques et transposés nous font progresser dans sa réflexion: Une Fille de Pasteur (A Clergyman’s daughter) et un essai Et Vive l'Aspidistra! (Keep the Aspidistra flying !)
Résumé: La fille de pasteur, c’est Dorothy. Elle mène une vie toute tracée dans une petite paroisse du Suffolk. Son dévouement à son pasteur de père, veuf et ronchon, est total. Elle s'occupe de la maison, de faire venir du monde à la messe, d’organiser des spectacles pour obtenir des dons…
Et son père râle sans cesse y compris sur ses paroissiens. Et puis - comme dans tous les récits d’Orwell, - intervient un premier point de rupture. Un matin, Dorothy se réveille toute seule dans une rue de Londres sans argent et sans savoir comment elle est arrivée là. Elle se joint à un groupe qui part à travers la campagne pour aller cueillir du houblon. Beaucoup mendient et volent. Un de ses compagnons, Nobby, reste près d’elle pour la cueillette. Le travail est dur, mais au moins ils gagnent de quoi se nourrir et se loger. Cependant Nobby continue à voler et un jour la police l'arrête. Second point de rupture. Dorothy se retrouve seule à nouveau mais, cette fois, la situation lui est salutaire. Elle se met réfléchir sur elle-même, sur son amnésie, sur un avenir autonome. Elle devient d’abord une enseignante très inventive, habituant avant tout les fillettes à réfléchir par elles-mêmes. Mais la directrice n’est intéressée que par l’argent et Dorothy est licenciée. Après 8 mois d'absence, elle rentre donc chez elle et, apparemment, reprend sa vie là où elle l'avait laissée. En réalité, tout est différent. Elle voit lucidement que l’Eglise peut rester bien loin des hommes, que l’enseignement peut saboter l’aptitude des jeunes à se construire utilement. Elle a compris que les humains ne sont pas des produits, mais qu’ils se produisent eux-mêmes. C'est le courage qui fait les hommes et leurs décisions qui font d’eux ce qu’ils sont.
Une Fille de Pasteur, inédit en français jusqu’en 2008, défend cette autre conviction d’Orwell: nous avons la capacité affective et mentale de faire des choix pour rester humains et, si les circonstances deviennent trop difficiles, de nous faire aider pour refuser les impulsions destructrices.
Dans le conte Et vive l’Aspidistra!, Orwell indique, avec plus d’humour encore, ce qu’il prend au sérieux.
Résumé: La famille de Gordon Comstock, comme beaucoup de familles anglaises de la classe moyenne, a connu des périodes florissantes puis elle s’est fanée. Le terme «fané» est mis en lien avec une humble plante d'appartement, très répandue, nommée l’aspidistra laquelle, malgré de mauvais traitements, résiste aux désagréments de la vie. Gordon décide qu’il sera cette plante robuste. Mais cela ne va pas de soi. Au collège, il doit apprendre à réagir au harcèlement de camarades prétentieux qui se moquent de sa passion d’écrire. A la fin des études, il dégotte un boulot dans une librairie: il est près des livres, il peut écrire…Mais nouvelle déception ! Ses textes ne sont pas publiés. Son honnêteté intellectuelle lui fait rejeter le jargon socialiste et donc l’appui de son ami Ravelston, directeur d'une revue littéraire. C’est que Ravelston vit comme un pacha, pas du tout en conformité avec les idées qu’il proclame. Pour vraiment sauver l’aspidistra Gordon, lui, va choisir la droiture et la subtilité d’analyse.
Les méfaits de l'argent, voilà aussi ce que dénonce ce texte. Toujours nuancé, Orwell ne s’en prend pas d’abord aux personnes qui, par leur origine, disposeraient d’argent, il cible les pouvoirs nocifs que cet argent va avoir sur les mentalités, les distances qu’il provoque entre les humains, cette tristesse, cette solitude. Sauver l'aspidistra procure, par contre, un vrai plaisir et s’inscrit dans un désir de réalisation jouissif. Au fur et à mesure de ses expériences et de ses écrits, l’écrivain nous livre cette conviction sans concession: les hommes peuvent et doivent, où que la vie les ait plantés, agir pour connaître ce bonheur.


Motihari Birmanie aujourd’hui




La famille Orwell Etudes Retour en Birmanie

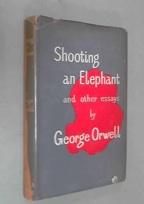

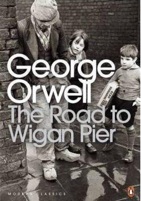
Avant de prendre part à la guerre civile en Espagne, Orwell choisit encore de vivre au cœur du pays minier anglais. S'il ne peut pas, à cause de sa santé, prendre la place du mineur, il nous fait découvrir son quotidien. Il décrit les journées infernales de dur labeur et de trajet dans les galeries, les conditions d'hygiène, de santé, de logement, de sécurité, les salaires, la vie familiale, les plaisirs… Pour qui veut entrer dans la pensée politique d’Orwell, ce livre est déterminant car il dévoile en même temps la brutalité des oppresseurs et les ressources de la fraternité humaine. Il contient aussi ses interrogations puis ses conclusions sur les idéologies dites socialistes.
De cette expérience nait Le Quai de Wigan (The Road to Wigan Pier) – 1937. Ce récit ne renvoie pas à un passé aboli, la vie ouvrière, rouage d’une industrie basée sur le charbon. L’écrivain fait des constatations valables partout et à long terme. Ainsi il parle du machinisme, de ses apports mais aussi de ses conséquences dangereuses sinon mutilantes. Pas question pour Orwell de soutenir à-tout-va la technologie qui peut aussi induire une perte des forces vives et de l’intelligence, une illusion hédoniste mettant au second plan les questions de justice et de liberté. Orwell pense que les hommes qui laissent les sociétés les mécaniser sans fin sont de moins en moins des «personnes», qu’ils deviennent transparents.
Par contre, au sein de la communauté minière, Orwell signale du bonheur, une pratique quotidienne du respect mutuel et de la réciprocité bienveillante, un niveau très agréable de common decency.
A Wigan, il ne trouve pas de mendiants ni de sans-abris. Les familles sont plus épanouies, malgré le dénuement, que bien des familles de la classe moyenne qu’il connaît bien. Voilà pourquoi les mineurs supportent le déni qui est fait de leur humanité, eux ne sont pas inquiets pour elle. Ce qui rend l’auteur particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c’est que, tout en montrant et l’inhumanité d’un système et une humanité persistante, il s’abstient de tout angélisme. A aucun moment, par exemple, il ne mythifiera une «classe» ouvrière. Il précise aussi le type de distance qu’il prend assez tôt avec l’intelligentsia ouvrière. Il a assisté à de nombreux rassemblements politiques au cours de son séjour à Wigan et il y a trouvé que bien des pathologies étaient apportées par ces intellectuels, beaux-parleurs narcissiques et hypocrites qui, inconsciemment peut-être, maintiennent l’ordre des puissants pour asseoir leurs carrières.
Fin 1936, nous retrouvons Orwell et sa femme Eileen en Espagne. Leurs analyses politiques font que, dans cette guerre contre le franquisme, ils ne pourront rejoindre que les milices du POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxista), une formation hétéroclite, mixte, avec certes des gauchisants de tous poils, anarchistes, anarcho-syndicalistes, trotzkistes mais pas de staliniens, avec aussi beaucoup de simples sympathisants, espagnols ou étrangers.
Orwell et Eileen découvrent la Catalogne au moment où le souffle révolutionnaire a, un temps, aboli les clivages. D’où le titre du livre : Hommage à la Catalogne, cette Catalogne où ils vont vivre une expérience humaine très forte, avec une solidarité au jour le jour. Et en même temps, Orwell va acter d’incroyables déformations de la réalité. En septembre 1937, il écrit à son ami, l’anthropologue Geoffrey Gorer: «Les récits des émeutes de mai à Barcelone, dans lesquelles je me suis trouvé impliqué, dépassent tout ce que j’ai pu voir quant à la falsification des faits.»
Blessé au cou en raison de sa haute taille, Orwell se retrouve hospitalisé à Barcelone. Il y assiste aux manœuvres militaires menées par le parti communiste pour s’emparer du pouvoir en Catalogne, aux liquidations (dont l’assassinat d’Andrès Nin), aux emprisonnements… et c’est de justesse que sa femme et lui parviennent à s’échapper. Leur bilan sur le stalinisme se confirme: une tromperie à laquelle se laissent prendre nombre d’intellectuels européens. Orwell en rappelle les manœuvres: l’assassinat mystérieux de Sergueï Kirov, soi-disant dauphin de Staline, assassinat-prétexte d’une vague d'épuration au sein du parti. Un scénario très ficelé. Les accusés des 3 procès dits «Procès de Moscou», membres de la vieille garde de Lénine, plaident tous coupables et en France, la Ligue des droits de l'Homme n'y voit rien à redire puisqu’ils s’auto-accusent. Plus de la moitié des élus du parti seront ainsi éliminés et remplacés par de jeunes militants qui n'ont rien connu des étapes de la Révolution et sont dévoués corps et esprit à Staline. Le pacte germano-soviétique de non-agression entre Hitler et Staline, mais d'agression contre la Pologne et d’autres pays des zones d'influence concourra au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Juste avant le début de ce terrible nouveau conflit, Orwell, en convalescence à Marrakech, écrit un texte intimiste Un peu d'air frais (Coming Up for Air).
Résumé: Au bord de ce gouffre guerrier, le personnage, George «Fatty» Bowling, surnommé Bouboule, a besoin d’aspirer une bouffée d’air frais. Il repart donc vers un lieu de son enfance, Binfield-le-bas. Il avait naïvement et bêtement cru que la Première Guerre mondiale le libérerait de cet environnement étriqué mais ce n’était pas vraiment le cas: il avait vieilli, il portait un dentier, était un commercial médiocre, payé à la commission et côté vie privée, sa femme s’était plutôt révélée une mégère près de ses sous. Bien sûr, à Binfield, George constate que des choses ont changé: avant, la Tamise regorgeait de poissons, des châteaux étaient abandonnés aux promeneurs, les enfants avaient plus de temps pour s'allonger sur le dos et regarder les nuages, mais voilà qu’intervient, comme d’habitude, le point de rupture du texte: Bouboule renoue avec les saucisses de son enfance.
«Je mordis dans une des saucisses Pour être franc, je ne m’attendais pas à leur trouver un goût très savoureux… Mais ce qui arrive alors est tout bonnement incroyable. […] Je vais essayer de vous en donner une idée. La saucisse avait la peau en caoutchouc, bien entendu, et mon dentier provisoire n’était pas trop bien ajusté. J’avais donc à faire une sorte de mouvement de scie pour entamer la peau. Et tout d’un coup, crac ! la chose m’éclate dans la bouche, comme une poire pourrie et je sens une atroce substance molle se répandre sur ma langue. Quant au goût ! Sur le moment je ne pouvais pas le croire. J’ai refait une tentative, j’y suis allé avec la langue cette fois. C’était du poisson. Une saucisse, et qui se prétend de Francfort, pleine de poisson ! Je me suis levé et j’ai décampé sans toucher à mon café. Dieu sait quel goût il aurait bien pu avoir… »
Ce court texte dévoile, avec un humour qui nous est devenu familier, deux nouvelles découvertes à connecter avec une approche valable du politique: la connerie des illusions liées à ces grandes guerres, toujours absolument désastreuses pour les populations civiles, et la vanité de la nostalgie.
Au début de la guerre, Orwell travaille toujours dans la réalité anglaise: il supervise des émissions à la BBC, il est correspondant de guerre pour The Observer. Eileen, elle, est employée au département de la Censure britannique et au ministère de l’Alimentation.
Mais leurs dénis politiques vont se mondialiser quand ils verront en 1945 se former la dite «sainte alliance»: Churchill-Roosevelt-Staline.