«LES HEROS MODERNES»
ARTICLE
par Charlotte Goëtz-Nothomb et le comité de rédaction de POLE NORD
© POLENORDGROUP
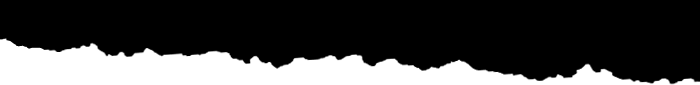



«LES HEROS MODERNES»
ARTICLE
par Charlotte Goëtz-Nothomb et le comité de rédaction de POLE NORD
© POLENORDGROUP

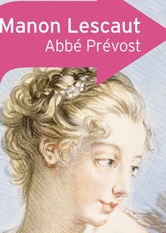
HEROS ET MYTHOLOGIE
Le héros classique se présente comme une grande figure aux qualités souvent étincelantes, à la psychologie fouillée mais dont le destin reste inscrit dans le cadre de la vie communautaire que matérialise remarquablement la mythologie.
Le développement de la vie sociale et de la personnalité antique trouve une expression très adéquate dans les tragédies d’Eschyle (-525 -456) ou de Sophocle (-496 -406). Les conflits que vivent ces héros sont parallèles à ceux qui opposent les divinités. Ils se trouvent écartelés entre des intérêts encore liés aux règles familiales, locales, basées sur les liens du sang (symbolisées par des divinités comme Cérès, Dionysos, les Euménides) et celles qui se dégagent des premières formes sociales plus élaborées, dont Apollon est un prototype. Si Antigone se heurte à Créon, c’est en tant que représentante de l’ancienne loi familiale refoulée par les nécessités d’un pouvoir d’Etat. Son frère Polynice a été condamné parce qu’il s’est posé en ennemi de cet Etat. Mais dire que de telles rivalités existent ne signifie pas pour autant une rupture au sein du monde antique. Les drames restent internes à un univers encore bien délimité, matrice des personnages. Tout advient en elle: la beauté, la grandeur ou les oppositions qui s’y manifestent expriment directement le sens du monde. Une des composantes de la tragédie antique est la figure du Destin, omniprésente et incarnée sur scène par le Chœur.
Envisageons à présent le héros de chevalerie tel qu’il apparaît dans des œuvres comme La Chanson de Roland (Xe siècle), L’Epopée du roi Arthur (XIIe siècle).
Il possède, lui aussi, une individualité propre, se distingue de ses compagnons par ses qualités de bravoure, d’endurance, son autorité morale, son sens de l’honneur, mais il est encore et toujours identifié au sort de la communauté. Dans l’épopée, le héros vit des aventures qui scellent le destin de son peuple. Dans l’héroïsme épique, contexte social et individu ne sont pas séparés ni subsumés l’un à l’autre, mais ils se renvoient continuellement de l’un à l’autre. Achille n’est pas plus séparable de la guerre de Troie et de l’esprit grec que le Cid ne l’est de la chevalerie.
Comme la tragédie antique, l’épopée est une grande forme littéraire qui trouve une sorte d’apogée dans La Divine Comédie où Dante (1265-1321) réussit à exprimer, allégoriquement, son propre enjeu. En s’appuyant sur tous les modèles du passé, l’auteur part à la découverte d’une transcendance. Cette «quête» lui impose d’affronter l’Enfer et mille morts, mais il ne fait pas de doute qu’il ne triomphe finalement de ses épreuves, comme Perceval ramènera immanquablement le Graal après tourments et épreuves (Chrestien de Troyes v.1135-1183).
TRANSITIONS
La structuration du héros moderne ne procède pas de la simple chronologie. Pour en dégager les caractéristiques, il faudra parfois sauter d’une époque à l’autre. Un trait se dégage, un personnage pionnier apparaît, et c’est le roman qui en est finalement la forme littéraire propre.
Ainsi Miguel de Cervantès (1547-1616) reste-t-il encore l’auteur d’épopées chevaleresques. Après son Don Quichotte, indiscutable héros moderne, il écrira encore Les travaux de Persilès et de Sigismonde.
En opérant un renversement de perspective, Don Quichotte ouvre, toutes grandes, les portes de la modernité. S’il possède encore en lui toute la grandeur du héros de chevalerie, il se retrouve – là réside la nouveauté – complètement en porte-à-faux par rapport au monde extérieur. On peut encore dire qu’il est un «chevalier héroïque», mais plus rien ne le consacre tel, si ce n’est sa propre assurance et ses déclamations enflammées. Il traîne avec lui, comme un boulet, son double, aussi antihéroïque que possible, l’ineffable Sancho Pança, dont le seul objectif est de s’adapter aux circonstances et d’éviter les conséquences funestes des lubies de son maître. Malgré tous ses efforts, Don Quichotte ne peut plus faire coïncider sa vie, ses actes et la réalité extérieure et il devient ainsi, malgré sa grandeur, une représentation caricaturale du héros d’épopée. Sa longue figure décharnée, son allure dégingandée et ses tics concrétisent cette inadaptation, cette séparation d’avec le monde. Et ce n’est pas un hasard si lui colle aux basques l’expression: «Se battre contre des moulins à vent».
Dans la modernité, nous allons rencontrer peu à peu des personnages d’une texture très neuve, avec lesquels s’amorce le règne de la subjectivité. L’individualité, dégagée d’un contexte englobant, se replie sur elle-même avant de chercher à se déployer. C’est à partir de ses propres forces que l’homme se lance à la conquête d’un monde dont il est, au départ, séparé et qu’il veut construire, reconstruire, modifier. Sur cette base s’élaborent les grands mythes de la période dénommée «Renaissance». La terre n’est plus le centre de l’Univers, mais cette découverte, c’est l’homme qui l’a faite et la confiance dans ses propres capacités autant que sa crainte devant l’inconnu sont désormais ses compagnons dans l’Odyssée moderne.
Il n’aurait pas été possible d’imaginer Faust ou Don Juan dans l’Antiquité. Aux arguments de son valet en faveur de la «destinée», d’un lien préétabli avec la collectivité, Don Juan oppose dédain et tranchante ironie. Il revendique son sort. Et qu’il soit sans entraves !
Faust refuse d’inscrire son savoir dans aucune discipline ou tradition extérieures à lui-même. Ces individualités constituées agissent en fonction de leur indépendance, c’est le particulier humain qui prend ainsi toute son ampleur. Dès le XVIe siècle se pose donc, dans toute la vigueur de son surgissement, la question qui ne cessera plus de tourmenter la modernité:
«Qui est cet homme que je puis maintenant concevoir comme un individu, comment va-t-il établir sa relation à lui-même, à son action, au monde ?»
C’est la densité de cette question qui donne aux œuvres de William Shakespeare (1564-1616) ce caractère poignant, cette profondeur que rien encore n’a dépassé. Les individualités sont rendues à elles-mêmes et leur ligne de conduite n’émane plus d’un principe extérieur. C’est sa propre identité qui mène le personnage au succès ou à la perte, qui en assure la grandeur. Ainsi en va-t-il pour Hamlet, un de ces héros modernes dont l’impact reste incommensurable. Alors que les commentateurs littéraires ont cherché 1001 raisons extérieures en vertu desquelles Hamlet ne tue pas son beau-père, on doit à l’approche freudienne le mérite de l’avoir déterminée dans l’ordre interne. Hamlet n’est ni un lâche, ni un faible. S’il ne peut tuer le roi qui a épousé sa mère, c’est que lui aussi a maintes fois nourri le désir de déposséder son propre père. Il y a là un mécanisme d’identification au rival qui, comme dans de nombreuses œuvres modernes, joue à double sens: tandis que le héros s’identifie à un autre personnage, il pousse le spectateur à faire de même à son égard.
Pour Œdipe, c’est le devenir de la Cité qui mène la tragédie. Certes, il réalise ses fantasmes, il tue son père et épouse sa mère, mais le drame surgit de nécessités externes: Thèbes, atteinte par la peste, exige du nouveau roi qu’il découvre le responsable de ce malheur collectif, qu’il calme la colère des dieux. Menant une enquête, il aboutit à la découverte de sa propre responsabilité.
A l’époque d’Hamlet, l’individu, s’il est bien devenu lui-même, n’est plus que lui-même. Tout en lui ayant assuré un développement individuel, l’évolution sociale a modifié en profondeur son élaboration psychique. Il n’a plus que des barrières internes pour ne pas céder à ses pulsions et il se retrouve seul à assumer la responsabilité et la culpabilité d’agir. De cette coupure vont surgir la richesse et les contradictions de l’univers moderne. Mais quelle mutation ! Elle indique la possibilité d’une universalisation des individus humains auxquels elle donne les rênes de leur vie. Pourtant, face à cette perspective inouïe, notre héros, sans plus d’amarres, à peine sevré, va être saisi d’une angoisse terrible.
De ce double mouvement vont naître les chefs-d’œuvre de la littérature moderne. Dans son étude sur le roman, Marthe Robert s’attache à montrer que la structure psychique du héros littéraire moderne est bien celle d’un enfant qui n’a plus de famille, mais le monde entier à ses pieds.
Tantôt, s’inscrivant dans le rôle du «bâtard», il entend sauter par-dessus tous les obstacles, conquérir la connaissance, l’amour, les amours, le pouvoir, agir sur le monde. Il a la fougue et la témérité de l’adolescent. Faust et Don Juan s’inscrivent dans cette lignée.
Tantôt il se vit comme un «enfant trouvé», il rejette ce monde qu’on lui propose et en revendique un autre plus sécurisant, plus idyllique. C’est la recherche d’un paradis perdu, d’un temps perdu.
Robinson Crusoé quitte une «terre des hommes» pour se réfugier dans son île et y reconstruire un autre monde. Avec l’île de Robinson prend naissance un des grands courants de l’Utopie moderne. Et l’Utopie possède une force indéniable, celle de la reconstruction. On ne lira jamais assez les écrits de Saint-Simon, Fourier ou Owen pour mesurer la puissance de ce désir de réélaboration et les trésors d’intelligence et d’imagination qu’il met en œuvre. Mais hantée par son souci du «sans retour», son aspiration mystique à la pureté, à l’harmonie, habitée par une nostalgie éperdue, cette robinsonnade court le risque inhérent à son point de départ: renouer avec le monde ancien, sous le prétexte d’une l’éternelle «nature humaine».
Ce mouvement si particulier d’une partie des romans modernes mérite l’analyse. On peut l’aborder, entre autres, avec Robinson Crusoé (Daniel Defoe 1660-1731), Tristram Shandy (Laurence Sterne 1713-1768), Paul et Virginie (Bernardin de Saint-Pierre 1737-1814), Erewohn (Samuel Butler 1835-1902) ou Jude l’Obscur (Thomas Hardy 1840-1928).
L’homme moderne s’avance seul et fragilisé, cela, personne ne songe à le contester, mais on reconnaît moins facilement que cette solitude et cette fragilité sont aussi des forces. On ne peut pas seulement voir dans le roman, dans ce recours à l’imaginaire, la seule preuve d’un désarroi fondamental. Le roman, en effet, a une histoire, il doit aussi être appréhendé comme une forme transitoire de l’expression du monde. Dans son développement, le roman s’oppose à la réalité prosaïque. Domaine de l’imaginaire, certes, mais d’un imaginaire qui cherche une vérité supérieure.
A la fin du XVIIIe siècle, c’est à la faveur de la Querelle des Anciens et des Modernes que le roman se joue de l’antinomie posée assez abstraitement entre Raison et Emotion, il se glisse dans le conflit entre Objectivité et Subjectivité, entre Tradition et Innovation, il met au monde cet individu émouvant et irritant, grandiose et dérisoire, ballotté, désespéré, mais plein de projets. Il lui offre un pays, un continent pour y déposer son existence précaire et son univers contradictoire.
On mesure avec Manon Lescaut (l’abbé Prévost 1697-1763) à quel point les sentiments exercent une emprise accrue sur la jeunesse, mais son auteur préface encore son livre en ces termes :
«L’ouvrage tout entier est un traité de Morale réduit agréablement en exercices».
Un traité de morale!
La Princesse de Clèves (Mme de La Fayette 1634-1693) dévoile un univers de sentiments et d’émotivité auquel il était interdit d’accéder auparavant et dont elle se défend encore.
Dans la première préface aux Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos (1741-1803), on trouve ceci :
«Notre avis est que si les aventures rapportées dans cet ouvrage ont un fonds de vérité, elles n’ont pu arriver que dans d’autres lieux ou d’autres temps et nous blâmons beaucoup l’auteur qui, séduit apparemment par l’espoir d’intéresser davantage en se rapprochant plus de son siècle et de son pays, a osé faire paraître sous notre costume et avec nos usages, des mœurs qui nous sont si étrangères.»
Jusqu’au XIXe siècle encore, le roman est considéré comme une forme «mineure» face aux grandes œuvres littéraires: la tragédie, l’épopée, la poésie. Tous les grands romanciers débutent d’ailleurs par des drames ou des poèmes. Mais une force irrésistible semble peu à peu les pousser vers la forme romanesque. Elle agit à la façon d’une passion coupable, se cachant sous des prétextes moralisateurs, n’osant pas encore revendiquer de front ses nouvelles conquêtes. Le héros de roman, s’il garde souvent la forme du chevalier d’autrefois, n’en est pas moins profondément transformé. La rupture entre le citoyen et l’Etat le frustre de buts chimériques. Les gouvernements, les tribunaux, les lois, l’armée, toute une réalité établie et prosaïque dressent des obstacles devant ses ambitions, ses aspirations. Il pousse alors son désir et ses exigences jusqu’à l’exaspération ou se replie dans la mélancolie.


REVOLTE ET RUPTURE
La figure du héros ou de l’héroïne moderne se précise: un homme, une femme, jeunes sans doute par ce caractère d’indétermination, par cette révolte face aux conseils de prudence de la famille, aux exigences de la société, des occupations professionnelles, des lois…
Ce jeune personnage est saisi au moment où il quitte quelque chose, rompt avec un passé.
Qu’on pense ici à Robinson, à Clarissa Harlowe (Samuel Richardson 1689-1761), à Julien Sorel (Stendhal 1783-1842) à Eugène Onéguine (Alexandre Pouchkine 1799-1837) ou à Werther (Goethe 1749-1832), ils partent à la conquête du monde, tombent amoureux… Et même lorsque Gustave Flaubert (1821-1880) nous présente Bouvard et Pécuchet, des héros finissants, ils reproduisent encore - d’une manière sarcastique et désabusée - l’indétermination de l’adolescence.
Le roman psychologique se hausse progressivement jusqu’au principe dramatique.
Il connaît une apogée avec des œuvres comme Madame Bovary (Flaubert) ou Anna Karénine (Tolstoï 1828-1910). Une forme importante est et restera la Confession, impulsée par Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Le récit est centré sur un personnage qui se raconte ou est raconté par un ami : il a laissé un journal ou une correspondance, découverts par hasard.
Mais le roman ne s’arrête pas non plus à cette forme. Témoin d’une époque en continuel bouleversement, où comptent l’esprit d’initiative et le sens de l’adaptation, le roman s’empare de toutes les sphères de la littérature, il annexe tous les genres et plie à sa marche forcée toutes les règles qu’il façonne, contourne ou dont il dérive le cours.
Notre héros, lui aussi, évolue. Il mélange audacieusement la vie et le rêve, la réalité et l’affabulation. Il est mis en demeure de choisir, agir, cesser de se complaire dans les «états d’âme», dans un narcissisme infantile. Simplement, il hésite sur les choix à prendre, il souffre de conflits violents avec le monde et avec lui-même. On trouve dans ces œuvres désenchantement, désaffection des idéaux passés. Parfois le héros quitte un monde jugé trop prosaïque ou trop vil et se soumet à de longues années d’apprentissage. Chez Goethe (1749-1832), chez Chateaubriand (1768-1848) ou chez Benjamin Constant (1767-1830), les héros, Werther, René, Adolphe ne doutent pas que leur vie ait un sens et leurs actes un but. Ils n’affirment pas encore ce scepticisme ouvert qui sera le fait de personnages ultérieurs. Le «bildungsroman» dont Wilhelm Meister de Goethe est le modèle de héros prouve assez quel souci a l’époque de redonner une armature aux individus, privés des repères antérieurs. Goethe veut dépasser la simple opposition «romantique» entre l’individu et le monde, mais on peut se demander si, par l’orientation qu’il donne à la résolution du conflit, celle de l’apaisement et disons-le, de la résignation, il ne va pas constituer un pôle de frustration supérieur qui incite les romanciers suivants à pénétrer dans l’analyse sociale.
Avec Stendhal (1783-1842) et Honoré de Balzac (1799-1850), le roman social devient le roman moderne par excellence. Pour Balzac, le personnage n’a de sens véritable qu’en tant que porte-parole d’un milieu, d’où cette volonté d’établir la grande fresque de La Comédie humaine. Si ses personnages, Goriot, Rastignac, Louis Lambert, Vautrin ont tellement marqué notre conscience et notre mémoire, c’est qu’ils sont à nouveau, comme chez Shakespeare, des «caractères». Le grand mérite de Balzac est aussi de montrer, à travers le mouvement de la société du XIXe siècle, le triomphe de l’Argent. Il décrit avec force ce «satanisme» qui s’est emparé du monde moderne. Le capitalisme a introduit un mouvement impétueux et destructeur qui bouleverse les vies, les actions, les sentiments. Les destinées ne reposent plus sur la seule base des passions individuelles: ambition, amour, pouvoir… c’est un autre diable qui mène la danse, cet argent multiforme qui dévaste ou réconcilie, surgit puis s’évanouit, pousse au bienfait ou au crime. Submergé lui-même par la puissance du mouvement qu’il décrit, Balzac, malgré ses nostalgies aristocratiques, est de loin l’écrivain du XIXe siècle le plus intelligemment «social». Souvent pantins, parfois conscients, ses héros ne s’écartent pas de la réalité qui modèle leur existence et les aliène. Il est vrai qu’il a proclamé ne pas accorder d’importance au «psychologique» et c’est sans doute grâce à ce postulat qu’il a pu donner une psychologie complexe, contradictoire et subtile à ses personnages !
La voie tracée par Balzac ne connaîtra pas de réelle filiation. Malgré ses indéniables qualités descriptives, l’œuvre d’Emile Zola (1840-1902), qu’on lui accorde souvent comme successeur, révèle une analyse moins pénétrante de l’univers moderne et de son mouvement contradictoire.
Stendhal se veut, lui aussi, un écrivain social. Le Rouge et le Noir est l’histoire de la société française sous la Restauration, La Chartreuse de Parme, un tableau de l’Europe de la Sainte-Alliance, Lucien Leeuwen, une analyse de la Monarchie de Juillet.
Ironie de l’histoire : plus il s’efforce à la fresque sociale, et plus Stendhal ressuscite le héros romantique! Tout se passe comme si un dédoublement s’était opéré dans ses personnages. D’une part, ils font preuve d’opportunisme, cherchant à s’intégrer dans leur temps, d’autre part, ils ne rêvent que pureté et idéaux révolus. Quel que soit leur point de départ, le paysannat pour Julien, l’aristocratie ruinée pour Fabrice ou la bourgeoisie d’argent pour Lucien, cet exil permanent de la conscience reste leur point commun. Ils mêlent cynisme et idéalisme déçu. «La fin justifie tous les moyens», proclame Julien Sorel au moment même où il se veut un enfant pur et désintéressé. Révolte et opportunisme forment un curieux alliage qui annonce le remords, la honte qui vont ronger le héros ultérieur. Ici, toutefois, c’est encore la séduction qui l’emporte.
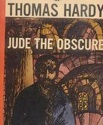
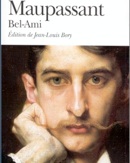


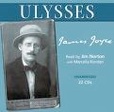
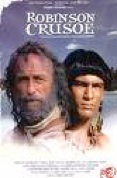
DESARROI, ERRANCE ET CULPABILITE
Si Stendhal est un romantique de cœur, Gustave Flaubert luttera toute sa vie pour ne pas succomber à ces mêmes inclinations. La haine du temps présent, les nostalgies aristocratiques ou révolutionnaires se joignent à son dégoût des masses. Flaubert introduit, sans le vouloir peut-être et au nom du rationalisme et du naturalisme, le principe du renoncement à la vie au profit de l’œuvre esthétique: «L’homme n’est rien, l’œuvre est tout…l’art est la seule chose bonne de la vie».
Ces idées que l’on retrouvera plus tard sous la plume de Franz Kafka (1883-1924) consacrent la séparation qui est l’essence du subjectivisme moderne et dont le développement ne s’arrêtera plus. Dès Madame Bovary, c’est le désarroi qui submerge le héros moderne. Si tourmenté fut-il auparavant, il ne doutait pas d’un but à donner à sa vie. Balzac dévoilait la complexité de l’univers moderne, ses horreurs et sa force; Stendhal reprenait le double aspect d’une adaptation impossible et de la nostalgie. Avec Flaubert, puis Guy de Maupassant (1850-1893), le héros se révèle tout à fait incapable d’assumer sa propre vie, il ne «survit» qu’en se projetant dans d’autres personnages. Le héros-type est le personnage de l’écrivain rédigeant son roman ou du cinéaste réalisant son film.
On peut établir ici une connexion immédiate avec l’évolution de la philosophie qui débouche à cette époque sur ce même doute devant le réel. Nous sommes prisonniers de la forme subjective de notre pensée, la réalité des choses nous échappe, l’action est un leurre.
La nouvelle vague cherchera désespérément de nouveaux ancrages. Dans la science, par exemple, dont Zola ou Charles Baudelaire (1821-1867) se réclament. Soit que l’art en soit le serviteur, soit qu’il soit science lui-même, comme l’exprimeront plusieurs courants. Les uns s’opposeront au positivisme étroit, les autres insisteront sur des questions formelles pour contrebalancer le «romantisme vieux jeu». Mais les héros ne se départissent pas d’un pessimisme voire d’un désespoir qui leur collent aux basques. Une autre caractéristique se dégage: la culpabilité.
CLIVAGES ET NOSTALGIE
C’est dans la littérature russe que nous en trouvons la marque la plus forte. Elle s’affirme au centre de l’œuvre de Fédor Dostoïevski (1821-1861) dont les personnages, capables des raisonnements les plus subtils, d’élans généreux, de pensées élevées, se trouvent en même temps submergés par la petitesse, le vice, l’inhibition, le dégoût. Un sombre combat se livre sans cesse entre deux parties clivées dans l’âme du héros. La description de cette lutte intérieure, dans ses phases les plus infimes est un talent bien spécifique de Dostoïevski. A chaque bataille perdue, le remords envahit ses personnages qui recommencent pourtant sans cesse des combats perdus d’avance et semblent se complaire dans ces dédales. Il faut donc considérer en même temps l’extraordinaire finesse de Dostoïevski à sonder l’âme humaine et l’incapacité de faire aboutir cette introspection vers quelque fin créatrice que ce soit, si ce n’est la réalisation de ces récits eux-mêmes.
Chez Léon Tolstoï (1828-1910), la reproduction des monologues intérieurs est proprement stupéfiante. Comme Dostoïevski, il est capable de représenter les nuances psychiques avec une précision inégalée. Ce talent si particulier accentue extraordinairement notre proximité avec leurs personnages, nous croyons les connaître intimement et on comprend que le cinéma ait aussi aisément transposé leurs aventures. Mais une fois encore, c’est le retour vers le passé qui scelle l’aventure. Y compris pour les auteurs: Tolstoï se perdra dans des rêveries sur un communautarisme idyllique et Dostoïevski dans le mysticisme politique et religieux. Dans Les Possédés et Les Frères Karamazov, on le retrouve panégyriste des autorités ecclésiastiques et séculières. Une triste fin pour un jeune décembriste enthousiaste !
On se doit donc aussi de situer en Russie des tentatives très originales d’échapper à cet univers plombé. A cet égard, il faut porter beaucoup d’attention aux textes d’Ivan Tourgueniev (1818-1883) qui, à plusieurs reprises, cherche une issue pour son héros. Il remettra en valeur un auteur comme Nikolaï Tchernychevski – en particulier dans son ouvrage Que faire ? qui influença extraordinairement toute une génération de jeunes Russes, mais dont jusqu’à la trace a disparu.
La littérature plus récente avec les personnages créés par Kafka, James Joyce (1882-1941), Robert Musil (1880-1942), si lucides et si étrangers à eux-mêmes, nous parle toujours de cette blessure, de cette aliénation, de cette rupture entre l’homme et son histoire. Le dégoût du réel est toujours assorti de la nostalgie du passé.


